Jazz in Arles douzième édition
Retour sur la fabuleuse édition en mai dernier de « Jazz in Arles » au Méjan, festival singulier concocté par un des programmateurs hors pair de la scène de jazz et des musiques actuelles, Jean Paul Ricard, directeur de l’AJMI en Avignon. Aidé par l’association du Méjan qui effectue un formidable travail, avec une équipe restreinte, cette manifestation
Pourrait, on se plaît à l’imaginer, devenir la version jazz d’un festival de piano comme La Roque d’Anthéron, dans le même département.
Cette année, il s’agissait d’une semaine autour du piano. Le piano, instrument parfait, instrument complet qui assure la triple fonction rythmique, harmonique et mélodique, ne pouvait que s’imposer dans l’histoire du jazz.
Autour de cette thématique passionnante, le programme construit était d’un éclectisme subtil : du trio NEW DREAMS de Jean Michel Pilc, aux VARIATIONS de Yaron Hermann qui a enthousiasmé le public arlésien, sans oublier le formidable récital « solo » de Myra Melford qui sut revenir sur l’héritage du blues…Ou encore le duo délicatement intimiste de Claudia Solal et Benjamin Moussay dans leur programme PORRIDGE DAYS ou le quartet de Pierrick Pedron, DEEP IN A DREAM, décidément pour nous l’artiste de l’année, la véritable révélation, un altiste généreux et fougueux qui entretient brillamment la tradition. Il fait partie de ces musiciens rares qui, au delà de la diversité des styles, avancent aujourd’hui sans nostalgie, soucieux du patrimoine collectif, mais ne figeant pas pour autant l’évocation du passé.
Oui, c’était bien du jazz qui était joué à Arles, du vrai, de l’authentique, revu, revisité avec intelligence, et respect, à l’exemple de ce qu’a pu faire Bill Evans, par exemple, qui inlassablement, a repris des standards ou des mélodies de Broadway pour les recréer en versions « originales ».
Si écrire sur la musique (ou le jazz) est le lieu d’ouvertures, de passages, de frontières abolies, d’euphories et d’admirations, voilà très précisément les sentiments éprouvés avec le groupe Echoes of Spring, réuni par Stéphane Oliva et François Raulin qui ont construit le programme du même nom, autour du Harlem piano Stride.
Dans une analyse musicologique passionnante réalisée dans le JAZZMAN d’avril dernier n° 123, François RAULIN nous éclairait sur sa démarche : Le stride est un style dense, complet où les pianistes assuraient la basse, l’harmonie et la mélodie sans soutien extérieur.
Comment faisaient donc Willie « The Lion » Smith, James P. Johnson, Fats Waller pour jouer avec autant d’allégresse et de virtuosité ? Fats Waller, hilare, tourné vers le public, cigare au bec, un verre de gin ou de bourbon bien rempli sur le piano, était capable de tout obtenir de l’instrument, comme de « plaquer un accord de 15 ème d’une seule main, la gauche chantant alors sur les tempos lents et medium » ? C’est qu’à force de jouer tous les soirs, la musique les traversait, les irriguait non pas mécaniquement mais en totale osmose. Les pianistes de stride étaient des sorciers, de vrais « ticklers », de diaboliques chatouilleurs de touches. Willie Smith essayait déjà de détourner le stride comme le feront la plupart des pianistes modernes, même si les trouvailles de ce style particulier furent adoptées par bon nombre de suiveurs. Cette influence est essentielle chez Art Tatum, très présente chez Count Basie, importante chez Monk…
Cette grande soirée jazz constituait une véritable introduction au piano stride que l’écoute des albums originaux de ces pianistes prodigieux complètera. Ainsi, dans la collection historique, JAZZ in PARIS chez Universal, de Daniel Richard, Alain Tercinet et François Lê Xuân, figure « Music on my mind » l’autobiographie musicale, de William The Lion Smith. Pour pleinement apprécier les arrangements des deux pianistes Raulin et Oliva, se référer aussi aux albums « Hot Piano » (Pearl/ Abeille) pour James P Johnson, « Ain’t Misbehaving » (Dreyfus Jazz Reference/Sony BMG) pour Fats Waller ou chez Classics, « The Chronological 1938-1940 » pour Willie The Lion Smith.
Le programme mis au point par Stéphane Oliva et François Raulin est une promenade intelligemment conçue autour de pièces emblématiques ou rares.
Soulignons par exemple la reprise d’un petit chef d’œuvre « In a mist », la seule composition écrite pour le piano par le jeune cornettiste blanc, le prodigieux Bix Beiderbecke, de Davenport (Iowa). Un gars qui avait de l’atmosphère dans les doigts (Boris Vian).
Il avait créé cette improvisation à la fin d’une nuit passablement embrumée, d’où son titre. Ce fut un solo de piano et une expérience uniques, une mélodie visionnaire par bien des aspects, où les pianistes retrouvent des accords inusités, un penchant pour la phrase en arabesque. « C’est un ragtime mélodieux et subtilement construit, éclairé de moments tendres, d’images insaisissables et délicates dont la présence dans le langage du jazz était alors inconnue » écrit Jean-Pierre Lion dans son ouvrage insurpassable, la biographie de Bix Beiderbecke aux Editions Outre Mesure. Il est à parier que la version de plus de dix minutes entendue à Arles fera date, avec une longue évocation impressionniste de Stephan Oliva.
La réussite de ce projet est d’avoir su démultipler les potentialités du piano stride, en le renouvelant par une forme et une instrumentation différentes. Car cette musique pleine de polyrythmies et d’écueils, est un véritable enjeu pour qui parvient à se la réapproprier avec élégance. Et il fallait des musiciens aguerris pour en découdre et mettre à vif cette tradition. Ce quintet dont les musiciens se connaissent depuis longtemps est la formation idéale : Laurent Dehors joue des clarinettes, clarinette basse et contrebasse, Christophe Monniot, des saxophone alto, baryton et sopranino; Sébastien Boisseau, infatigable, accroché au mât du rythme, forçat irrésistible du swing, assure sans batterie, une rythmique fervente à la contrebasse. Et ces trois musiciens sont entraînés dans cette folle aventure par les initiateurs du projet, François Raulin et Stephan Oliva, qui, sur le canal de droite, double certaines parties de basse, ou joue des particularités du Fender.
Le stride, issu du ragtime, procède plus de la variation que de l’improvisation pure . Ce qui ne saurait mieux correspondre à ces musiciens : à chaque fois, ils gagnent en aisance. Une complicité originale et exigeante dont chaque nouvel échange complète le tableau de variations en série.
Ce concert marquait l’aboutissement d’une tournée depuis mars 2006, date de création du programme à Grenoble, l’un des festivals du réseau Afijma. Le concert des Rencontres internationales de Nevers qui fut programmé (excellente initiative de Xavier Prévost sur France Musique en décembre dernier) permet de mesurer le travail accompli en quelques mois et on peut penser que le groupe, au Bordeaux Jazz Festival en novembre 2007, donnera encore une performance mémorable . D’autant que d’ici là, Echoes of Spring aura été enregistré, par l’ingénieur-son Boris Darley, en studio à Meudon, en juillet prochain, sur le label Mélisse du pianiste Edouard Ferlet (graphisme de Philippe Ghielmetti) .
Cette musique est une recréation de chaque instant, une évocation lumineuse où tous se livrent à corps perdu.
Les énergies libérées se déploient, toujours généreusement, et comme personne ne prend le pouvoir, la musique se développe à perte d’ouïe. Rien de plus beau que la complémentarité des deux pianistes qui jouent de tous les registres ; rien de plus troublant que les contrepoints des souffleurs, leurs unissons sensuels. Quand Christophe Monniot joue de ses saxophones, il se situe très exactement entre l’angle vif, l’écartement et l’arabesque, câlin au baryton, fougueux à l’alto, vacillant au sopranino. Il a participé au big band de Tous Dehors du clarinettiste Laurent Dehors qui équilibre sa turbulence gouailleuse, ses stridences chahuteuses, le comprenant parfaitement parce qu’ils pratiquent tous deux le « décalage oreille ».
Le groupe arrive à créer de petits instants d’éternité, prétextes à une chorégraphie imaginaire comme sur le virevoltant final, « Echoes of Spring », fragile mélodie de janvier 1939, dont l’arrangement de François Raulin a su garder les harmonies et le balancement de la main gauche. Voilà notre titre préféré et peut-être aussi celui des musiciens qui l’ont choisi comme titre du programme .
Il faudrait encore souligner la version décapante et drôle de « Ain’t misbehaving » de Fats Waller. La formation donne ici une variation qui devrait s’inscrire dans les nombreuses versions du thème. De même pour le « Morning Air » de Willie « The Lion » Smith, thème si mélodieux, porteur d’envolées fougueuses. C’est que les mélodies présentent souvent une douce violence avec des changements de tons, des ruptures de climat. Comme cet inquiétant “Child of disordered mind” (solo d’Earl Hines de 1940, réarrangé merveilleusement par Stephan Oliva). Véhémence des timbres, flamboyance encore, rugosités éclatantes dans le « Boogie Woogie on St Louis blues » toujours d’Earl Hines, très à l’honneur dans ce programme.
Cette traduction enthousiaste, généreuse, sensuelle, fidèle jusque dans la réinterprétation même, est la version française de la musique de jazz : elle sait caresser sans perdre sa force, faire entendre son chant sans tomber dans la romance. Avec Echoes of Spring, ce n’est pas seulement le printemps qui arrive par bouffées, c’est une rêverie en jazz, un bouleversant et mystérieux rappel d’un autre temps, réminiscence d’une histoire aimée.
Sophie Chambon
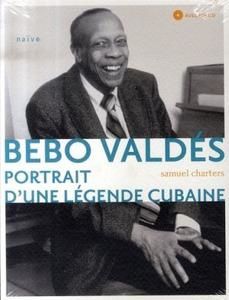




 J
J





