Djazz Nevers Festival Samedi 18 Novembre
Fin de partie (en)chantée : Madeleine et Salomon, Ellinoa.
Madeleine et Salomon
Théâtre Municipal 12H 30.
Eastern Spring
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_c6d474_madeleine-bis.jpg)
C’est le dernier jour du festival, le huitième. Le premier concert au Théâtre me permet de redécouvrir le duo apprécié à Arles au Mejan en mai dernier...On n’était pas les seuls à avoir aimé leur album, on apprécie encore plus le duo sur scène. Si l’heure est étrange pour les musiciens, peu habitués à jouer avant le déjeuner, elle est parfaite pour le chroniqueur encore frais et je vais savourer le premier concert du jour : la chanteuse Clotilde Rullaud (Madeleine) laisse apparaître toute son émotion mais aussi sa fantaisie et sa douceur dans cette suite de chansons, portées par des femmes le plus souvent, des histoires de vies qui se racontent en mots et musiques. Un duo piano voix qui saisit au coeur et à l’âme en reprenant des chansons pop du bassin oriental de la Méditerranée, des années soixante et soixante-dix que nous ne connaissons pas du tout pour la plupart d’entre nous. “Chansons d’amour, de mort, de révolte”, des thèmes universels qui s’inscrivent dans un espace géographique très particulier ( Israel, Egypte, Liban, Turquie, Maroc, Tunisie ). Explorer les identités choisies, vécues ou revendiquées en soulignant aussi ce que signifie être né “ici”, “être de quelque part”.
L’attraction est immédiate, loin du folklore touristique, on sent la proximité immédiate en dépit de langues différentes entre tous ces airs, ces cultures.
Après les “protest songs” de chanteuses américaines du disque précédent, ce répertoire humaniste, inscrit dans un temps révolu, où la vie était plus fluide, entre hélas singulièrement en résonance avec l’échec des printemps arabes, d’où ce titre d’Eastern Springs (No Mad music). Et encore plus tragiquement avec la violence des événements depuis le 7 octobre dernier. On est subjugué par le piano élégiaque et doucement répétitif sur lequel s’élève la voix fragile sculptant les mots du poète palestinien Mahmoud Darwich ( version initiale “Matar Naem” libanais du groupe Ferkat Al -Ard). Et que dire de cette merveilleuse ballade israélienne “The prettiest girl in the Kinder garten”? Le duo a opéré une sélection minutieuse sur plus de 200 titres pour n’en conserver que 9 et s’est livré à un travail de traduction, en anglais le plus souvent tout en gardant les mélodies et leurs rapports harmonico-rythmiques. La voix de Clotilde Rullaud est plus qu’attachante, grave avec des aigus étranges sur cette petite fiction égyptienne “Ma Fatsh Leah” du groupe Al Massrien, qu’entraîne un piano au groove hypnotique.
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_27d04d_salomon.jpg)
Les rôles sont parfaitement distribués, Alexandre Saada ( Salomon) ne fait pas qu’accompagner, emploi souvent obligé du pianiste avec chanteuse, il chante aussi et sa voix instrumentale souligne sans effort la ligne de chant, uni avec sa partenaire dans une même respiration comme dans le libanais entêtant “Do you love me?” qui s’achève en un murmure.
On est assez loin du monde originel du jazz commun à tous deux. Néanmoins le duo a travaillé des arrangements de ces versions originales en improvisant des fragments personnels, intitulés justement “Rhapsodies”, c’est à dire des pièces libres utilisant des motifs folk, des effets électroniques. Le pianiste quand il “prépare son piano” n’utilise qu’un seul petit effet qui n’est pas superflu, et cela n’arrivera qu’une fois, glissant diverses feuilles de partitions sur et entre les cordes induisant un son étrange, “sale”, de sable qui crisse ou de verre ou de plastique froissé. Une musique singulière, de la “pop expérimentale” avec des impros.
Ainsi se suivent dans un enchaînement bien construit en ronde ces textes d’auteurs jusqu’au final qui se situe en Grèce et y reste avec le rappel plus grave sur le manque, l’absence. Mais ce chant sensible et fièvreux n’arrive pas à entamer l’impresson de sérénité que laisse ce concert. Un moment de douceur et d’exaltation partagés.
Ellinoa
Théâtre municipal 17h.00
Nous enchaînons avec du chant et ce n’est pas pour nous déplaire avec le projet de Camille Durand en sextet sur la vie et fin tragique d’Ophélia. The ballad of Ophelia aurait t' elle quelque résonance avec “Ballad of Melody Nelson” de Gainsbourg ?
En jouant avec les lettres de son patronyme, la chanteuse s’est donné un nom de scène poétique Ellinoa plus adapté au sort de la malheureuse promise, sacrifiée par la folie d’Hamlet.
J’avais entendu la chanteuse dans Rituals de l’ONJ Maurin avant que, sur les conseils éclairés de Franck Bergerot, j’écoute le concert retransmis sur France Musique du même ONJ où avec Chloe Cailleton, les deux voix s’emparaient d’une partie de cette geste joycienne inadaptable Anna Livia Plurabelle (André Hodeir). Surprise de la voir enfin en “douce” Ophélie dans cet Ophelia Rebirth, nommé ainsi pardoxalement, car le projet reprend vie après avoir été brutalement interrompu par le covid.
Douze tableaux réactualisent la triste histoire de la blonde héroïne immortalisée par les Préraphaélites et John Everett Millais dans le tableau où, tel un lys à la tige brisée, elle flotte dans son voile parmi les algues auxquelles se mêle sa blonde chevelure.
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_9fe097_2560px-john-everett-millais-ophelia.jpg)
Il y a de cela dans la (plus) rousse incarnation de la chanteuse aux pieds nus qui a choisi un costume de scène qui enveloppe la peau du rôle. Très pédagogique elle explique en français l’évolution de cette jeune fille qui découvre la vie, pleine de rêves et d’espoirs, un peu trop grands peut être pour ne pas subir un violent désenchantement que sa sensibilité exacerbée ne pourra surmonter . Une adolescente de nos jours et de tous temps en sa révolte et son désir d’embrasser la vie sans renoncer à ses illusions.
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_8a5cca_ellinoa-seule.jpg)
La voix est magnifique, pleine, bien timbrée, chaude, avec des aigus parfaitement maîtrisés. Une véritable chanteuse qui pourrait ne pas scater, même si elle sait le faire car dans ce programme acoustique de cordes frottées de musique de chambre, le chant en anglais ( british) n’impose pas de revenir au jazz….
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_9b07e9_ellinoa-1.jpg)
L’accompagnement est épatant: non seulement la guitare électrique de Pierre Perchaud m’évoque les accents rock prog de ces gestes anglaises médiévales des tous premiers Genesis-on se rapprocherait même de certaines excentricités de Kate Bush avec Peter Gabriel (comme par hasard) mais les cordes délicates du violoncelle de Juliette Serrad, de la contrebasse d’Arthur Henn (très belle voix) et de la guitare (Pierre Tereygeol) offrent un écrin de choix à Ellinoa. Et en plus, ils la supportent vocalement et renforcent l’émotion dans un choeur enchanteur.
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_fe8837_le-groupe-en-concert.jpg)
Un bonheur d’écoute même si la fatigue qui se ressent après ces jours intenses ne me permet pas de suivre dans le texte original les moments forts de ce parcours tragique jusqu’à l’abandon final… N’ayant pas écouté le CD du projet, je ne peux comprendre si ces douze tableaux sont vraiment nécessaires….Mais ne boudons pas le plaisir de cette fin d’après midi.
Pour la dernière soirée, je dois me résoudre à reporter mon dernier texte sur la suite astrale de Leila Olivesi à lundi, la journée du dimanche étant dévolue au retour (pesant) de Nevers à Marseille dont je retrouve immédiatement à l’arrivée à St Charles le bruit et les embarras...
NB : Toutes les photos des artistes à la balance et en concert sont de Maxime François.
Sophie Chambon

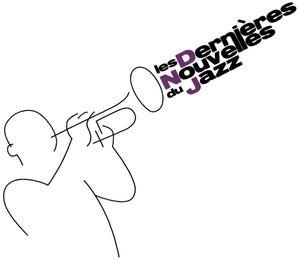
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_593b66_th2atre.jpg)


/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_82ca38_cafe-charbon.jpg)
/image%2F1365231%2F20231119%2Fob_c4210a_batteuse-essor.jpg)
/image%2F1365231%2F20231118%2Fob_27dbf9_romain-baret-quintet.jpg)
/image%2F1365231%2F20231119%2Fob_f069ba_emmanuel-borghi.jpg)
/image%2F1365231%2F20231119%2Fob_0b44e4_ariel-tessier.jpg)
/image%2F1365231%2F20231119%2Fob_34f860_luca-aquino.jpg)
/image%2F1365231%2F20231118%2Fob_b25e5c_duo-italien.jpg)
/image%2F1365231%2F20231119%2Fob_8bd824_ablaye-cissoko.jpg)
/image%2F1365231%2F20231119%2Fob_0d1232_kora.jpg)
/image%2F1365231%2F20231118%2Fob_a1e4b6_calebasse.jpg)
/image%2F1365231%2F20231118%2Fob_c5a78b_goubert-en-action.jpg)
/image%2F1365231%2F20231118%2Fob_972239_african-jazz-roots.jpg)
/image%2F1365231%2F20231120%2Fob_e14db5_affiche-djazz-nevers.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_12ee68_hypnos-et.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_933b72_noce.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_b5e4ab_benjamin-flament.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_fa81a0_paul-lay.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_6e70ad_a-cohen-a-la-trompette.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_707d0a_fl-tiste.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_e19761_avishai-cohen.jpg)
/image%2F1365231%2F20231117%2Fob_3125ec_s-blaser-r-lossing-b-mintz.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fa-vYztx8Zfk%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F1365231%2F20231111%2Fob_350120_innanen-pasborg-piromalli-can-you.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FkBi0U8aT5n0%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F1365231%2F20231111%2Fob_2b5a94_continuo.jpg)
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FGw9Btfs5njM%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F1365231%2F20231111%2Fob_9474ca_1-titodr.jpg)
/image%2F1365231%2F20231111%2Fob_2841b6_2-andajm.jpg)
/image%2F1365231%2F20231110%2Fob_ef9167_zodiac-suite-cover-hd.jpg)
/image%2F1365231%2F20240121%2Fob_257f35_fabian-mary.jpg)
/image%2F1365231%2F20231108%2Fob_d85fd2_visuel-m-turner-live-at-v-v.jpg)
/image%2F1365231%2F20231108%2Fob_c86e39_miki-yamanaka-cover.jpeg)
/image%2F1365231%2F20231108%2Fob_c7b50e_1-cofaso.jpg)
/image%2F1365231%2F20231108%2Fob_a4f546_2-boeli.jpg)
/image%2F1365231%2F20231108%2Fob_cf464a_3-lequar.jpg)
