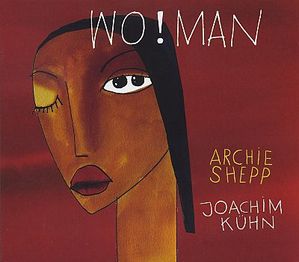Kind of Blue 2011
Samuel Blaser (tb), Russ Lossing (p), Thomas Morgan (cb), Paul Motian (dm)

Il y a des albums dont on pourrait parler comme de véritables ouvrages. Ou comme des études presque littéraires. De ces albums qui portent véritablement en eux un vrai propos. C'est exactement le cas de cet album fourmillant d'intelligence que le tromboniste suisse consacre pour une grande partie a la relecture de pièces de Monteverdi. A une approche jazz de la musique de la renaissance et baroque.
Samuel Blaser qui vit entre New-york et Berlin, deux haut lieux de création s'il en est livre en effet une passionnante exploration personnelle de cette musique, matériau précieux et base de digressions abstraites, de libres improvisations à partir d'un support sur la base mélodique au plus proche de l'original et qui évoque bien sur les arias de celui qui fut l'inventeur de l'Opéra.
Samuel Blaser qui s'apprête a publier tout prochainement un album en compagnie de Marc Ducret et de Gerald Cleaver, est un musicien rare. Pas seulement l'instrumentiste exceptionnel qui libère le trombone de tous ses carcans pour lui donner ici une expressivité sublimée, mais aussi un musicien qui propose, un musicien qui invente, qui crée et qui donne vie à ce qu'il crée. Un musicien en mouvement en quelque sorte. Maitre en animation, en "renaissance" en quelque sorte, au sens littéral de redonner vie à ce qui n'est plus. Travail d'orfèvre aussi.
De cette musique-là on entend bien la respiration intérieure. Elle ouvre des espaces d'improvisations très libres autour de ce que l'on pourrait appeler des variations. L'esprit "free" (au pied de la lettre) peut s'y retrouver quant à la liberté que les musiciens s'y accordent. Liberté formidablement encadrée par les talents d'arrangeurs de Samuel Blaser. C'est bien là l'esprit de ce mouvement historique (La Renaissance) : la liberté de création encadrée dans des canons académiques et formels.
A ses côtés, Paul Motian est ici le coloriste de l'ensemble, au pinceau fin et subtil. Ses effleurements de peau donnent le frisson. Quant à l'entente avec le pianiste helvétique Russ Lossing, elle éclate ici, là où chacun propose sa propre lecture, sans que l'on sache vraiment si l'on est dans le domaine de l'improvisation ou de l'écrit.
Et il faut absolument venir et revenir sans cesse à cet album qui recèle de vraies merveilles cachées. Découvrir le jeu fascinant de Samuel Blaser dont le discours captive et fascine. Aucun développement linéaire mais des reliefs et des sons, des sons râpeux au grain épais, des glissandos plaintifs, des growls qui arrachent des bouts de terre et de ciel, des évocations comme des récitatifs magnifiquement incarnés. Y revenir toujours. Et découvrir ces digressions sur Frescobaldi ou encore sur cet émouvant Ritornello de Monteverdi. Il y a cette approche de la musique où celle-ci est si expressive qu'elle semble presque nous parler et discourir avec nous.
Et dans cet album aux milles contours l'émotion qui effleure toujours avec légèreté pour ceux qui y prêterons l'oreille.
Grand disque
Jean-marc Gelin






 Jean-Marc Gelin
Jean-Marc Gelin