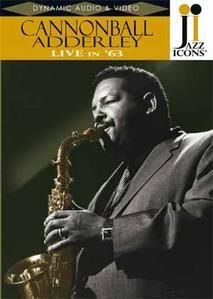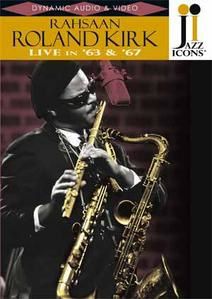La collection Jazz Icons constitue ce qui ce fait de mieux en matière d’édition DVD de concerts ou de prestations télévisées de jazzmen américains de passage en Europe. Un travail soigné de restauration de l’image et du son, un livret explicatif et complet de 24 pages, intégrant photos et anecdotes truculentes. Et enfin et surtout, des professionnels sérieux et honnêtes qui payent les droits d’éditions et publient des documents exceptionnels avec l’accord des ayant droits (chose rare dans l’industrie du DVD où la plupart des documents d’époque sortent en édition pirate et trouvent malheureusement des réseaux de distributions normaux).
Parmi les 7 nouveaux DVD qui constituent la troisième série de la collection Jazz Icons (tous excellents), notre choix s’est concentré sur trois grands saxophonistes incontournables, présents dans trois DVD indispensables.
Lionel Eskenazi
JJJJ CANNONBALL ADDERLEY: « Live in ’63 » HHHH
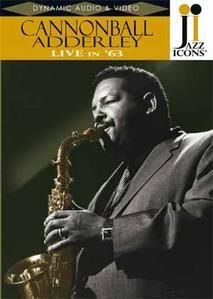
Au début de l’année 1962, Julian « Cannonball » Adderley transforme son quintet en sextet, en intégrant le génial flûtiste, saxophoniste ténor et hautboïste Yusef Lateef. Cette formation légendaire qui comprend aussi Nat Adderley au cornet, Joe Zawinul au piano, Sam Jones à la contrebasse et Louis Hayes à la batterie, va devenir l’un des meilleurs et des plus inventifs orchestres de jazz de cette période. Ils remporteront un très grand succès en sillonnant pendant deux ans les scènes du monde entier et enregistreront (exclusivement en « live ») des disques essentiels (In New-York, In Europe, Jazz Workshop Revisited et Nippon Soul). La première partie de ce DVD nous les présente en concert en Suisse à Lugano, le 22 mars 1963. Il s’agit d’un formidable concert qui a d’ailleurs été édité en CD et qui est correctement filmé par la TV suisse, en vidéo noir et blanc, mettant en avant chaque musicien du sextet. Yusef Lateef se taille la part du lion, notamment à la flûte sur Angel Eyes (titre inédit joué en quartet et absent de l’édition CD), et au hautbois sur le bluesy Trouble in Mind. Les frères Adderley en grande forme effectuent des chorus ébouriffants à chacune de leur intervention. Joe Zawinul, méconnaissable, portant un smoking et une coupe de cheveux fortement marquée par une raie horizontale sur le côté, assure un swing pétillant et très churchy. En fermant les yeux et en se concentrant sur son jeu de piano, on pourrait croire que ce pianiste blanc autrichien est un afro-américain natif de harlem ! La complémentarité rythmique du contrebassiste Sam Jones et du batteur Louis Hayes est tellement extraordinaire que le grand Oscar Peterson les intègrera ensemble dans son trio, trois ans plus tard. On peut apprécier leur talent de soliste sur Trouble in Mind pour Sam Jones et sur Bohemia After Dark pour Louis Hayes. La deuxième partie de ce DVD est moins intéressante, elle a été enregistrée deux jours avant dans un studio TV en Allemagne, dans un décor affreux, la réalisation est un peu brouillon et propose des cadrages assez inhabituels (on intègre des bouts de musiciens dans un décor plutôt que le contraire). Le groupe ne joue que trois titres dont Jessica’s Day et Jive Samba, déjà interprétés lors du concert de Lugano. C’est donc pour le magnifique Brother John (une composition de Lateef interprétée au hautbois et dédiée à John Coltrane) que toute notre attention se portera.
Lionel Eskenazi
JJJJ RAHSAAN ROLAND KIRK : « Live in ’63 & ’67 »
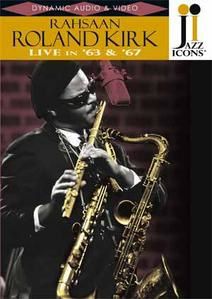 Ce DVD est indispensable car l’écoute des albums de Roland Kirk ne suffit pas à bien comprendre et à pouvoir adhérer pleinement à l’univers musical de ce phénoménal multi-instrumentiste, qui à lui seul sonnait comme une section de saxophones (il jouait aussi diverses flûtes, sifflets, appeaux et sirènes). Roland Kirk jouait de trois saxophones simultanément : le sax ténor, le manzello (sorte de soprano recourbé) et le stritch (sorte de long alto droit). Cette « performance » ne faisait pas de lui une bête de foire, mais un véritable musicien-compositeur qui entendait sa musique à plusieurs voix, un artiste aveugle qui a développé une hyper-sensibilité et une ouïe démesurée, ainsi que des capacités respiratoires hors du commun (la maitrise de la respiration circulaire). Le DVD démarre par une émission de la TV belge (Jazz Pour Tous) en 1963, avec une très belle image parfaitement restaurée et une réalisation sobre et efficace, toujours au service de la musique. Il est accompagné d’un trio efficace où l’on distingue un jeune batteur de 25 ans au jeu vif et subtil qui n’est autre que Daniel Humair ! Sur Three for the Festival, Kirk réalise un véritable tour de force, introduisant le morceau avec ses trois saxophones, puis proposant un remarquable chorus de flûte avant de revenir à ses furieux saxos. Puis l’on se retrouve au Rolando, club de jazz Hollandais avec une réalisation plus nerveuse. Une version de Bag’s Groove qui décoiffe avec un Daniel Humair en grande forme et une très belle interprétation à la flûte de Lover Man. La troisième partie du DVD se situe quatre ans plus tard en Norvège lors du festival de Kongsberg. Kirk y est encore plus impressionnant (il a enregistré entre temps de remarquables albums comme Rip, Rig & Panic, Here Comes a Whistleman ou Now Please don’t you Cry Beautiful Edith) et se trouve entouré de pointures tel que le contrebassiste NHOP ou le pianiste au jeu bluesy Ron Burton. La mise en images n’est pas mémorable mais les versions de Blue Rol (où il joue de la clarinette !) et de Making Love After Hours sont de grands moments de musique très intense.
Ce DVD est indispensable car l’écoute des albums de Roland Kirk ne suffit pas à bien comprendre et à pouvoir adhérer pleinement à l’univers musical de ce phénoménal multi-instrumentiste, qui à lui seul sonnait comme une section de saxophones (il jouait aussi diverses flûtes, sifflets, appeaux et sirènes). Roland Kirk jouait de trois saxophones simultanément : le sax ténor, le manzello (sorte de soprano recourbé) et le stritch (sorte de long alto droit). Cette « performance » ne faisait pas de lui une bête de foire, mais un véritable musicien-compositeur qui entendait sa musique à plusieurs voix, un artiste aveugle qui a développé une hyper-sensibilité et une ouïe démesurée, ainsi que des capacités respiratoires hors du commun (la maitrise de la respiration circulaire). Le DVD démarre par une émission de la TV belge (Jazz Pour Tous) en 1963, avec une très belle image parfaitement restaurée et une réalisation sobre et efficace, toujours au service de la musique. Il est accompagné d’un trio efficace où l’on distingue un jeune batteur de 25 ans au jeu vif et subtil qui n’est autre que Daniel Humair ! Sur Three for the Festival, Kirk réalise un véritable tour de force, introduisant le morceau avec ses trois saxophones, puis proposant un remarquable chorus de flûte avant de revenir à ses furieux saxos. Puis l’on se retrouve au Rolando, club de jazz Hollandais avec une réalisation plus nerveuse. Une version de Bag’s Groove qui décoiffe avec un Daniel Humair en grande forme et une très belle interprétation à la flûte de Lover Man. La troisième partie du DVD se situe quatre ans plus tard en Norvège lors du festival de Kongsberg. Kirk y est encore plus impressionnant (il a enregistré entre temps de remarquables albums comme Rip, Rig & Panic, Here Comes a Whistleman ou Now Please don’t you Cry Beautiful Edith) et se trouve entouré de pointures tel que le contrebassiste NHOP ou le pianiste au jeu bluesy Ron Burton. La mise en images n’est pas mémorable mais les versions de Blue Rol (où il joue de la clarinette !) et de Making Love After Hours sont de grands moments de musique très intense.
Lionel Eskenazi
JJJJ SONNY ROLLINS : « Live in ’65 & ’68 »
 Au Danemark en 1965, Sonny Rollins, le crane rasé de près, joue en trio au festival de jazz de Copenhague. Il est accompagné du contrebassiste NHOP et du batteur Alan Dawson. Les caméras danoises n’ont que trois musiciens à filmer, mais elles ont vite compris que c’est sur Sonny qu’il faut se concentrer et surtout ne pas le lâcher, car il est dans un grand jour et va faire exploser la baraque. On peut même dire que ce soir là, il invente un nouvel instrument : le saxophone ténorme ! Après deux excellents morceaux qui lui servent de warm-up (There will Be Another You et le célèbre St Thomas), il passe aux choses sérieuses en entremêlant dans le même morceau les thèmes d’Oleo et de I Can’t Get Started. Il va alors partir dans une furieuse improvisation mémorable de 30 minutes sans beaucoup reprendre son souffle, avec des clins d’œil et des réminiscences à 52nd Street Theme et Alfie, puis il intègre le thème de Sonnymoon for Two et enchaîne sans temps mort sur Darn That Dream et Three Little Words. Un instant de pur bonheur et qui est en plus, remarquablement bien filmé par la TV danoise. Ces trente minutes (qui se situent entre la 24 ème et la 54 ème minute du DVD) demeurent un des plus grands moments de jazz télévisé que j’ai pu voir. Sonny est à son sommet et s’envole très loin, noue emmenant avec lui dans sa furieuse improvisation, l’émotion est à son comble et il est très difficile d’en sortir indemne. Il est d’ailleurs fort dommage qu’il n’existe pas un CD de ce mémorable concert. La deuxième partie du DVD nous le montre toujours à Copenhague, mais dans un studio de la télévision danoise, trois ans plus tard. Sa barbe a poussé et il joue cette fois-ci en quartet (avec Kenny Drew au piano et le même NHOP à la contrebasse). Il va effectuer une remarquable prestation (bien que très en-dessous par rapport concert précédent) avec notamment une belle version de On Green Dolphin Street . Les images sont belles et bien composées, l’éclairage est soigné et le montage efficace par rapport à la narration musicale. Lionel Eskenazi
Au Danemark en 1965, Sonny Rollins, le crane rasé de près, joue en trio au festival de jazz de Copenhague. Il est accompagné du contrebassiste NHOP et du batteur Alan Dawson. Les caméras danoises n’ont que trois musiciens à filmer, mais elles ont vite compris que c’est sur Sonny qu’il faut se concentrer et surtout ne pas le lâcher, car il est dans un grand jour et va faire exploser la baraque. On peut même dire que ce soir là, il invente un nouvel instrument : le saxophone ténorme ! Après deux excellents morceaux qui lui servent de warm-up (There will Be Another You et le célèbre St Thomas), il passe aux choses sérieuses en entremêlant dans le même morceau les thèmes d’Oleo et de I Can’t Get Started. Il va alors partir dans une furieuse improvisation mémorable de 30 minutes sans beaucoup reprendre son souffle, avec des clins d’œil et des réminiscences à 52nd Street Theme et Alfie, puis il intègre le thème de Sonnymoon for Two et enchaîne sans temps mort sur Darn That Dream et Three Little Words. Un instant de pur bonheur et qui est en plus, remarquablement bien filmé par la TV danoise. Ces trente minutes (qui se situent entre la 24 ème et la 54 ème minute du DVD) demeurent un des plus grands moments de jazz télévisé que j’ai pu voir. Sonny est à son sommet et s’envole très loin, noue emmenant avec lui dans sa furieuse improvisation, l’émotion est à son comble et il est très difficile d’en sortir indemne. Il est d’ailleurs fort dommage qu’il n’existe pas un CD de ce mémorable concert. La deuxième partie du DVD nous le montre toujours à Copenhague, mais dans un studio de la télévision danoise, trois ans plus tard. Sa barbe a poussé et il joue cette fois-ci en quartet (avec Kenny Drew au piano et le même NHOP à la contrebasse). Il va effectuer une remarquable prestation (bien que très en-dessous par rapport concert précédent) avec notamment une belle version de On Green Dolphin Street . Les images sont belles et bien composées, l’éclairage est soigné et le montage efficace par rapport à la narration musicale. Lionel Eskenazi







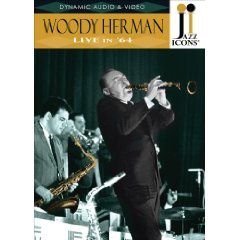


 Eagle Vision
Eagle Vision