Marie Buscatto
Éditeur : CNRS (28 juin 2007)
Collection : SOCIO.ETHN.ANTH
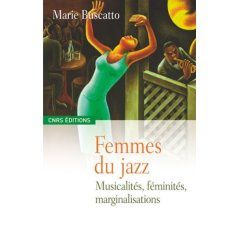 Marie Buscatto est chercheur en Sciences Sociales. Elle travaille comme Maître de conférences en Sociologie à l’Université de Paris I et au sein du laboratoire de George Friedmann au CNRS. C’est donc à ce titre et comme travail de recherche qu’elle a déterminé comme sujet de son étude la place des femmes dans le jazz. Entendez par là qu’il s’agit d’un champ plutôt restreint puisque non seulement les femmes restent peu nombreuses dans le jazz d’une manière générale mais qu’en plus Marie Buscatto confine son étude aux femmes dans le jazz hexagonal. C’est dire qu’elles se comptent sur le doigt de la main.
Marie Buscatto est chercheur en Sciences Sociales. Elle travaille comme Maître de conférences en Sociologie à l’Université de Paris I et au sein du laboratoire de George Friedmann au CNRS. C’est donc à ce titre et comme travail de recherche qu’elle a déterminé comme sujet de son étude la place des femmes dans le jazz. Entendez par là qu’il s’agit d’un champ plutôt restreint puisque non seulement les femmes restent peu nombreuses dans le jazz d’une manière générale mais qu’en plus Marie Buscatto confine son étude aux femmes dans le jazz hexagonal. C’est dire qu’elles se comptent sur le doigt de la main.
Son angle d’attaque consiste à travailler sur ce que nous observons dans le jazz comme miroir très grossissant de ce qui se passe dans d’autres secteurs de la société. Dans le jazz (comme ailleurs) le rôle et la place des femmes dans un univers aux codes hyper masculinisés et, lâchons le mot, très machiste est en effet limité à des représentations globalement très sexuées. Apparaissent ainsi au cours des entretiens menées par la chercheuse, des barrières « non écrites » infranchissables. Les femmes sont en majorité cantonnées au rôle de chanteuses, contraintes de jouer avant tout sur les caractéristiques de leur féminité. Le clivage entre la chanteuse et les musiciens apparaît clairement et les chanteuses font un travail qui est ainsi très dévalorisé par les instrumentistes (hommes) qui dénient souvent à ces chanteuses le qualificatif de « musicien ». La pratique du jazz vocal est encore considérée pour grand nombre d’instrumentiste comme une voie mineure du jazz qui ne demande que peu de qualités musicales. Une sorte de sous -musique de laquelle émerge des figures de chanteuses souvent dévalorisées et abordées sur d’autres caractéristiques que celle que l’on utiliserait pour qualifier des musiciens.
L’auteur n’oublie pas cependant qu’il existe des femmes instrumentistes. Elles sont peu nombreuses (même si Buscatto oublie de mentionner leur part croissante). Mais Buscatto n’oublie pas en revanche de signaler la part très secondaire qu’il leur est réservé. D’abord parce que l’intégration au réseau des musiciens passe souvent chez les femmes par une stratégie matrimoniale, la part des musiciennes vivant en couple avec un homme du même sérail musical étant très fréquente (Ce qui au passage pourrait s’appliquer à un grand nombre de milieux socioprofessionnels fermés). Si la part des femmes instrumentistes leader est très faible, celles qui sont appelées comme pour jouer en sidewoman avec un autre groupe y est exceptionnellement rare. A partir de ces deux constats Marie Buscatto semble un peu tourner autour de son sujet. Elle enchaîne des chapitres fort intéressants qui tournent autour de quelques idées fortes mais néanmoins un peu simples si elles ne dépassent la simple approche anthropologique.
Dès lors deux réserves s’imposent à la lecture de l’ouvrage. En premier lieu le fait que sur une étude portant sur un champ d’investigation aussi restreint il n’y ait pas d’approche quantitative. On serait en effet en droit d’attendre d’une étude scientifique quantifiée. Qu’elle aille au-delà de la simple approche anthropologique faite de constatation et d’entretiens avec musiciens et chanteurs pour en livrer une approche quantitative. Car dans cet espace restreint et étroit un travail statistique aurait été utile. Nous aurions ainsi aimé dénombrer les musiciennes dans le paysage, la part des chanteuses, celle des instrumentistes, leur progression, leur nombre dans les écoles, leur place dans les programmations, les enregistrements en leader ou en sidewomen.
L’autre réserve tient à la forme de l’enquête réalisée. En effet les différents intervenants ne sont pas nommés. Toutes les citations sont attribuées non nominativement (de type : « selon une instrumentiste femme de 45 ans »). Ce qui soulève un problème réel. Non pas que l’on puisse mettre en doute l’intégrité de son travail. Mais plus parce que en refusant de nommer ses intervenants, elle a certes obtenue une parole plus libre mais apporte un bien involontaire caution d’une certaine manière à un système très fermé et dans lequel les pressions sociales existent bel et bien au point d’en être parfois insupportable. L’auteur soulève de manière très discrète la question de la discrimination positive en jazz. Cette question qui peut faire sourire mérite néanmoins d’être posée. Dans son introduction elle rappelle la pratique au États-Unis qui consiste lors des recrutements de chefs d’orchestre à les faire additionner derrière un rideau de manière à ce que les jurys ignorent le sexe du postulant. Les résultats en sont étonnants et démontrent si besoin en était le chemin qui reste à faire pour parvenir à la parité ici comme ailleurs. Pour que le jazz se féminise enfin. Jean-Marc Gelin






 Décidemment les ouvrages d’Alain Gerber se suivent et… se ressemblent tous. Chaque année, l’animateur de l’émission vedette « le jazz est un roman », revient vers le mois de novembre (avant les fêtes) avec ses biographies romancées où il fait parler des personnages réels dans une sorte de fiction biographique où se mêle des monologues inventés à des faits avérés. On en a savouré quelques uns comme Louie (Armstrong), Billie (Holiday), Chet (Baker), Charlie (Parker) etc…
Décidemment les ouvrages d’Alain Gerber se suivent et… se ressemblent tous. Chaque année, l’animateur de l’émission vedette « le jazz est un roman », revient vers le mois de novembre (avant les fêtes) avec ses biographies romancées où il fait parler des personnages réels dans une sorte de fiction biographique où se mêle des monologues inventés à des faits avérés. On en a savouré quelques uns comme Louie (Armstrong), Billie (Holiday), Chet (Baker), Charlie (Parker) etc… Philippe Robert est journaliste. Il collabore à plusieurs publications dont notamment Vibrations, Jazz Magazine ou les Inrockuptibles. Plutôt familier de cette musique à la marge, ayant lui même été à un moment très proche du groupe mythique Sonic Youth, Philippe Robert s’intéresse et nous passionne pour tous ces expérimentateurs, ces décalés de la musique, ces révolutionnaires du son.
Philippe Robert est journaliste. Il collabore à plusieurs publications dont notamment Vibrations, Jazz Magazine ou les Inrockuptibles. Plutôt familier de cette musique à la marge, ayant lui même été à un moment très proche du groupe mythique Sonic Youth, Philippe Robert s’intéresse et nous passionne pour tous ces expérimentateurs, ces décalés de la musique, ces révolutionnaires du son.




