JJJ Chris Cody Coalition : « Conscript »
Nocturne 2007
 Avec une intrigante énergie, le disque « Conscript » de ce quartet commence par un suspense, idéal pour ouvrir les hostilités. La « coalition » de Chris Cody fonctionne dès les premières notes comme une machine, bien huilée, dirigée par la « cool-issante » attitude d’un tromboniste au cœur tendre, Glenn Ferris. La présence de la paire d’inséparables rythmiciens donne une impression de déjà-vu, impression bien plus rassurante qu’encombrante. Laurent Robin, fidèle aux cotés de Bruno Rousselet, participe à ce projet de la même façon qu’à tous les autres, c’est-à-dire avec la plus fervente des générosités du moment. Les compositions viennent du pianiste australien, leader du groupe. Laissant place aussi bien aux mesures composés qu’aux poétiques envolées sonores, en passant par un bref regard sur le Jazz et sa culture, et tout cela parfois avec beaucoup d’humour. À la fois baladés et à la fois attendris, à la fois bousculés et à la fois chatouillés. L’esprit de surprise domine. Facile à croire quand on connaît la redoutable malice des protagonistes. La relation entre eux n’est pas seulement fusionnelle, mais elle est en plus une interaction fonctionnelle. Le résultat est un disque soigné, à la prise de son et au mixage excellents. Peut-être un bémol sur le visuel du support cd. Hélas en ces périodes illégitimes de téléchargements abusifs, un effort des musiciens dans le domaine visuel n’est jamais inutile, sans être taxé de carriérisme. Quoiqu’il en soit, on ne s’inclinera jamais assez devant le talent de ces musiciens, qui, pour l’anecdote, se retrouvent chaque année en tant que musiciens-accompagnateurs des candidats au concours d’entrée de la classe de Jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ce qui ne fait qu’honorer d’autant plus la richesse de leur groove. C’est un disque extrêmement rythmique, le dandinement des corps est provoqué par le précis touché d’une contrebasse, allant directement à l’essentiel. On sent donc chez lui une grande expérience dans ce genre de contexte. Inutile d’en rajouter pour le vieux briscard Glenn Ferris. C’est chez Chris Cody que la maturité est ressentie différemment. Est-ce dû aux origines lointaines ? Le son personnalisé de ces voicings convoque en permanence la Beauté. Cette esthétique se rapprochant même du son européen. Mais aussi dans ce quartet, à certains moments, le swing revient au galop, profond et pénétrant, avec par-dessus des accords suspendus aux consonances bien afro-américaines. Tout en feeling, c’est un album complet certes, une boîte à idées sûrement. Des idées expérimentées à l’extrême par de férus passionnés, au service de la « session ». Est-ce une erreur que de les citer comme de parfaits « sidemen » ? Non, il s’agit bien là d’un métier : celui de servir la Musique. Il n’y a que du positif à user d’un tel disque, transporté par cette éternelle joie de vivre que nous apporte la Musique de Jazz.
Avec une intrigante énergie, le disque « Conscript » de ce quartet commence par un suspense, idéal pour ouvrir les hostilités. La « coalition » de Chris Cody fonctionne dès les premières notes comme une machine, bien huilée, dirigée par la « cool-issante » attitude d’un tromboniste au cœur tendre, Glenn Ferris. La présence de la paire d’inséparables rythmiciens donne une impression de déjà-vu, impression bien plus rassurante qu’encombrante. Laurent Robin, fidèle aux cotés de Bruno Rousselet, participe à ce projet de la même façon qu’à tous les autres, c’est-à-dire avec la plus fervente des générosités du moment. Les compositions viennent du pianiste australien, leader du groupe. Laissant place aussi bien aux mesures composés qu’aux poétiques envolées sonores, en passant par un bref regard sur le Jazz et sa culture, et tout cela parfois avec beaucoup d’humour. À la fois baladés et à la fois attendris, à la fois bousculés et à la fois chatouillés. L’esprit de surprise domine. Facile à croire quand on connaît la redoutable malice des protagonistes. La relation entre eux n’est pas seulement fusionnelle, mais elle est en plus une interaction fonctionnelle. Le résultat est un disque soigné, à la prise de son et au mixage excellents. Peut-être un bémol sur le visuel du support cd. Hélas en ces périodes illégitimes de téléchargements abusifs, un effort des musiciens dans le domaine visuel n’est jamais inutile, sans être taxé de carriérisme. Quoiqu’il en soit, on ne s’inclinera jamais assez devant le talent de ces musiciens, qui, pour l’anecdote, se retrouvent chaque année en tant que musiciens-accompagnateurs des candidats au concours d’entrée de la classe de Jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ce qui ne fait qu’honorer d’autant plus la richesse de leur groove. C’est un disque extrêmement rythmique, le dandinement des corps est provoqué par le précis touché d’une contrebasse, allant directement à l’essentiel. On sent donc chez lui une grande expérience dans ce genre de contexte. Inutile d’en rajouter pour le vieux briscard Glenn Ferris. C’est chez Chris Cody que la maturité est ressentie différemment. Est-ce dû aux origines lointaines ? Le son personnalisé de ces voicings convoque en permanence la Beauté. Cette esthétique se rapprochant même du son européen. Mais aussi dans ce quartet, à certains moments, le swing revient au galop, profond et pénétrant, avec par-dessus des accords suspendus aux consonances bien afro-américaines. Tout en feeling, c’est un album complet certes, une boîte à idées sûrement. Des idées expérimentées à l’extrême par de férus passionnés, au service de la « session ». Est-ce une erreur que de les citer comme de parfaits « sidemen » ? Non, il s’agit bien là d’un métier : celui de servir la Musique. Il n’y a que du positif à user d’un tel disque, transporté par cette éternelle joie de vivre que nous apporte la Musique de Jazz.
Tristan Loriaut







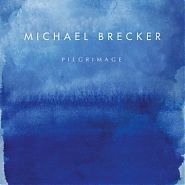

 Il y a dans le jeu du pianiste américain Bill Charlap quelque chose qui tient d’une immense délicatesse. Enregistré en live à l’occasion des 70 ans du Village Vanguard, le pianiste y revisite le territoire des standards de jazz de Autumn in New York à It’s only a paper moon en passant par The Lady is a tramp
Il y a dans le jeu du pianiste américain Bill Charlap quelque chose qui tient d’une immense délicatesse. Enregistré en live à l’occasion des 70 ans du Village Vanguard, le pianiste y revisite le territoire des standards de jazz de Autumn in New York à It’s only a paper moon en passant par The Lady is a tramp En 1969, il y a 38 ans, Jacques Coursil, alors trompettiste virtuose de la scène free-jazz, compagnon de Sunny Murray, d’Antony Braxton, d’Albert Ayler, de Frank Wright, se retire discrètement de la scène après l’enregistrement de son deuxième album, The way ahead, pour se consacrer à la linguistique, qu’il enseignera à Caen et aux Antilles avant de partir à l’université Cornell aux États-unis. En 2005, à la demande d’un de ses anciens élèves de Cornell, un certain John Zorn, qui l’accueille sur son label Tzadik, il rejoue enfin de la trompette en public et enregistre son troisième album, Minimal Brass. Il a passé dit-il ses trente dernières années à démanteler la trompette, à supprimer de son jeu toutes les affèteries, à travailler inlassablement son instrument, pour ne conserver que le souffle continu. Less is more…ne peut-on que se dire à l’écoute de ce sublime album. Avec Clameurs, Jacques Coursil appelle avec les mots du poète martiniquais Franz Fanon au refus du « «meurtre de ce qui a de plus humain dans l’humain, la liberté ! […] Je demande que l’on me considère à partir de mon désir […] Exister absolument ! » Né en 1939 à Paris, Jacques Coursil ne découvre sa terre d’origine martiniquaise qu’à 40 ans. C’est une terre de brassage culturel, de passage, de lumière, de chaos, de labeur, de blessures, de révoltes mais surtout de cris étouffés. « Le cri de l’esclave, de l’opprimé, s’étouffe dans sa gorge. S’il crie, on le bat, il est mort –le cri à pleine voix est le privilège de l’homme libre. Dans la langue des poètes, le cri noué se mue en écrit », explique Jacques Coursil dans le livret qui accompagne son nouvel album. Son projet ici est à la fois politique, musical et linguistique et se décline en « 4 oratorios pour trompettes et voix ». Coursil rend hommage dans leur langue (français, créole, arabe),
En 1969, il y a 38 ans, Jacques Coursil, alors trompettiste virtuose de la scène free-jazz, compagnon de Sunny Murray, d’Antony Braxton, d’Albert Ayler, de Frank Wright, se retire discrètement de la scène après l’enregistrement de son deuxième album, The way ahead, pour se consacrer à la linguistique, qu’il enseignera à Caen et aux Antilles avant de partir à l’université Cornell aux États-unis. En 2005, à la demande d’un de ses anciens élèves de Cornell, un certain John Zorn, qui l’accueille sur son label Tzadik, il rejoue enfin de la trompette en public et enregistre son troisième album, Minimal Brass. Il a passé dit-il ses trente dernières années à démanteler la trompette, à supprimer de son jeu toutes les affèteries, à travailler inlassablement son instrument, pour ne conserver que le souffle continu. Less is more…ne peut-on que se dire à l’écoute de ce sublime album. Avec Clameurs, Jacques Coursil appelle avec les mots du poète martiniquais Franz Fanon au refus du « «meurtre de ce qui a de plus humain dans l’humain, la liberté ! […] Je demande que l’on me considère à partir de mon désir […] Exister absolument ! » Né en 1939 à Paris, Jacques Coursil ne découvre sa terre d’origine martiniquaise qu’à 40 ans. C’est une terre de brassage culturel, de passage, de lumière, de chaos, de labeur, de blessures, de révoltes mais surtout de cris étouffés. « Le cri de l’esclave, de l’opprimé, s’étouffe dans sa gorge. S’il crie, on le bat, il est mort –le cri à pleine voix est le privilège de l’homme libre. Dans la langue des poètes, le cri noué se mue en écrit », explique Jacques Coursil dans le livret qui accompagne son nouvel album. Son projet ici est à la fois politique, musical et linguistique et se décline en « 4 oratorios pour trompettes et voix ». Coursil rend hommage dans leur langue (français, créole, arabe),
